La Russie, l’Ukraine et l’Occident (2014–2022), entre responsabilité juridique et responsabilité géopolitique
Dans la plupart des discours publics occidentaux, la guerre en Ukraine commence le 24 février 2022, lorsque les forces russes lancent une offensive généralisée contre l’ensemble du territoire ukrainien. Pourtant, de nombreux analystes — parmi lesquels Luc Ferry ou Alain Bauer, régulièrement invités sur LCI — rappellent que le conflit débute en réalité en 2014, avec l’occupation puis l’annexion de la Crimée. Dès février de cette année-là, la Fédération de Russie recourt à la force armée pour s’emparer d’un territoire souverain.
Dans le même temps, le Donbass bascule dans la violence lorsque des groupes séparatistes, lourdement armés, s’emparent de bâtiments administratifs dans plusieurs villes de l’Est. Ce double épisode — l’annexion de la Crimée et l’insurrection armée dans le Donbass — constitue l’entrée des deux États dans un conflit internationalisé régi par le droit international.
Ces événements ne surgissent pas dans un vide stratégique. Ils s’inscrivent dans une reconfiguration géopolitique profonde, amorcée après l’effondrement de l’Union soviétique. À partir de 1999, l’OTAN ne cesse de s’élargir vers l’Est, tandis que les États-Unis et plusieurs capitales européennes, encouragés par les nouveaux membres de l’Alliance, écartent les mises en garde du Kremlin et ignorent ses tentatives d’intégration à l’ordre politique et économique européen. Les propositions russes de créer une « maison commune » de la sécurité européenne, tout comme ses protestations contre l’élargissement de l’OTAN, sont systématiquement marginalisées ou renvoyées à un supposé « réflexe impérial russe ».
Dès lors, plusieurs questions se posent à l’analyste. Sur le plan juridique, à quel moment peut-on affirmer que la Russie et l’Ukraine sont engagées dans un conflit armé ? Et selon les textes internationaux, quel État peut être qualifié d’agresseur ? Mais au-delà du droit, une interrogation plus large émerge : une fois désigné l’agresseur juridique, doit-on pour autant le considérer comme l’unique responsable politique ou éthique du conflit ?
La réflexion n’est pas nouvelle. Au XIXᵉ siècle, l’historien François-Auguste Mignet remarquait déjà que « le véritable auteur de la guerre n’est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire ». Cette formule, saisissante par sa lucidité, résume la problématique de cette étude. La guerre russo-ukrainienne ne peut être comprise ni par la seule faute initiale de l’un des belligérants ni par l’unique agressivité présumée d’un camp ; elle doit être replacée dans une perspective diachronique, où l’accumulation de décisions politiques, militaires et stratégiques a rendu l’affrontement, sinon inévitable, du moins prévisible.
Si la Russie, après avoir envahi la Crimée en février 2014 et soutenu une insurrection armée dans le Donbass : en cela, la Russie peut être légitimement qualifiée d’agresseur au sens du droit international, il n’en reste pas moins que cette qualification juridique demeure insuffisante pour comprendre l’origine profonde du conflit. En vérité, les décideurs des États-Unis et des capitales de l’Europe occidentale, animés par une détermination farouche à étendre l’OTAN et l’Union européenne, ont adopté une approche interventionniste musclée. Leurs actions étaient souvent inspirées par la perspective stratégique des néoconservateurs américains. Ils peuvent être, à ce titre, considérés comme les premiers et principaux responsables de ce conflit.
Tout d’abord, il est crucial de comprendre comment le droit international autorise l’établissement de la date de début du conflit en 2014 et la désignation de la Russie comme l’instigatrice de l’agression. Dans un deuxième temps, il faut décrire les actions militaires, politiques et diplomatiques menées par les deux camps entre 2014 et 2022. Finalement, il est indispensable de démontrer pourquoi la responsabilité géopolitique conjointe du bloc occidental est engagée, et en quoi il peut être perçu comme l’instigateur ayant rendu la guerre « nécessaire » selon Mignet, non pas parce qu’il a déclenché le conflit, mais parce qu’il a volontairement contribué à créer un contexte stratégique menant inexorablement à l’éruption de 2014, puis à l’invasion de 2022.
I. 2014 : une agression au sens du droit international
La Crimée : occupation militaire, référendum sous contrôle et annexion
À partir de la fin février 2014, des unités armées sans insigne — les fameux « petits hommes verts » — prennent position sur les axes stratégiques de la péninsule de Crimée : bâtiments officiels, nœuds routiers, infrastructures militaires. Les forces ukrainiennes sont encerclées, neutralisées, parfois désarmées sans combat ouvert. Dans ce contexte d’action militaire en cours, un « référendum » est tenu le 16 mars 2014. Selon les dirigeants locaux, la Russie remporte une victoire écrasante avec une majorité écrasante. Le 27 mars 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies vote en faveur de la résolution 68/262, réaffirmant son engagement envers « la souveraineté, l’indépendance politique, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Elle souligne que le référendum criméen n’a pas été autorisé par Kiev et appelle tous les États à s’abstenir de reconnaître toute modification du statut de la Crimée[1]. Au regard du droit, il s’agit bien d’une annexion obtenue par la force, et non d’un exercice valide du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La Russie devient ainsi, dès le printemps 2014, l’État agresseur à l’égard de l’Ukraine.
Le Donbass : une insurrection armée structurée et le rôle décisif de Moscou
Dans le Donbass, la séquence suit un enchaînement précis. Le 6 avril 2014, des groupes armés pro-russes s’emparent de bâtiments administratifs à Donetsk, Kramatorsk et Horlivka. L’OSCE signale en parallèle l’occupation durable du bâtiment du Service de sécurité (SBU) à Louhansk et d’autres édifices publics en oblast de Donetsk. Le 12 avril, un groupe d’environ cinquante hommes armés menés par Igor Girkin (Strelkov), venu de Crimée, investit Sloviansk : Ces hommes s’emparent du commissariat de police, du siège du SBU, et de la mairie.[2]. L’intéressé lui-même, dans un entretien de novembre 2014, déclarera : « J’ai appuyé sur la gâchette de la guerre. Si notre unité n’avait pas franchi la frontière, tout se serait éteint. »[3]
Ce n’est qu’après ces prises de contrôle armées que Kiev déclenche, le 13 avril, une « opération antiterroriste » pour reprendre la main. L’ordre juridique international reconnaît, en principe, à tout État le droit de recourir à la force sur son propre territoire pour lutter contre une insurrection armée, à condition de respecter les règles du droit des conflits armés.
Dès l’été 2014, le rôle russe cesse d’être implicite. Des rapports d’ONG, des investigations indépendantes et un important travail d’analyse de sources ouvertes montrent l’intervention directe d’unités russes régulières, notamment lors des combats d’Ilovaïsk (août 2014) et de Debaltseve (début 2015).[4] [5] Dans le même temps, des rapports documentent des frappes massives de roquettes contre les forces ukrainiennes à proximité de la frontière, tirées depuis le territoire de la Fédération de Russie, en particulier lors de l’attaque de Zelenopyllia du 11 juillet 2014, qui fait au moins 37 morts parmi les militaires ukrainiens.[6] [7]
Compte tenu de cette série d’événements — insurrection armée planifiée, direction assurée par un cadre russe, acheminement d’armes et de combattants, tirs d’artillerie depuis la Russie, implication de forces régulières — la plupart des experts et des organisations internationales concluent que la Russie ne se contente pas d’être un « médiateur » ou un « État voisin concerné » depuis 2014, mais qu’elle est bel et bien devenue une partie prenante au conflit, en tant qu’agresseur.
II. L’usage de la force par l’Ukraine : un droit de riposte encadré, des dérives documentées mais non systématiques des deux côtés.
Reconnaître la responsabilité première de la Russie ne revient pas à absoudre l’Ukraine de toute critique. Le droit international humanitaire impose à chaque partie à un conflit — y compris à l’État qui se défend — de respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans la conduite des hostilités. Les forces ukrainiennes ont-elles respecté ces principes entre 2014 et 2022 ?
Entre 2014 et 2015, plusieurs organisations de défense des droits de la personne documentent des violations commises tant par les forces pro-Kiev que par les forces séparatistes appuyées par Moscou. Human Rights Watch met ainsi en évidence l’usage de roquettes à sous-munitions par l’armée ukrainienne dans la ville de Donetsk à l’automne 2014, en soulignant que de telles armes, utilisées dans des zones densément peuplées, sont par nature indiscriminées et peuvent constituer des crimes de guerre.[8]. D’autres rapports pointent des bombardements indiscriminés autour de Louhansk, qui ont causé un nombre significatif de victimes civiles.[9]
Amnesty International prouve des cas de détentions arbitraires, de tortures et de mauvais traitements deux côtés. Le rapport Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine[10] (mai 2015) décrit, à partir d’entretiens avec d’anciens détenus, des exécutions sommaires et des actes de torture commis à la fois par des milices séparatistes (notamment les bataillons Prizrak et Sparta) et par certains bataillons volontaires pro-Kiev, tels que Aïdar ou Right Sector.[11]
Ces exactions — parfois de gravité extrême — ne traduisent cependant pas une politique délibérée et assumée de ciblage systématique des civils par l’État ukrainien. Elles relèvent plutôt d’une dérive réelle mais localisée, souvent imputable à des unités mal encadrées, dans un contexte de guerre chaotique.
Les rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies fournissent un cadre plus global. Entre mi-avril 2014 et le 1ᵉʳ décembre 2016, l’ONU recense près de 9 800 morts et 22 800 blessés, toutes catégories confondues (civils, forces ukrainiennes, combattants des groupes armés).[12] Ces rapports insistent sur un point : toutes les parties ont commis des violations, mais l’ampleur et la nature des exactions diffèrent selon les acteurs et les périodes ; ils soulignent également l’« impunité rampante » pour de nombreux homicides illégaux, ce qui fragilise durablement l’État de droit.[13]
En résumé, l’Ukraine :
- est juridiquement fondée à employer la force pour lutter contre une insurrection armée sur son territoire ;
- a, dans l’ensemble, agi dans ce cadre, tout en se rendant coupable, par certaines unités, de violations sérieuses des lois de la guerre ;
- Au cours de la période allant de 2015 à 2022, il n’y a pas eu de campagnes militaires massives pour « écraser » les républiques séparatistes. L’Ukraine a plutôt adopté une posture défensive le long d’une ligne de front stabilisée après l’accord de Minsk II.
Cette appréciation nuancée — ni blanc ni noir — est indispensable pour éviter toute lecture manichéenne et conserver un regard fidèle aux faits.
III. Les responsabilités géopolitiques occidentales : un terrain d’affrontement préparé de longue date
Si la qualification juridique du rôle russe est claire, la compréhension politique du conflit impose d’élargir la focale. Depuis l’effondrement de l’URSS, l’ordre de sécurité européen n’a pas été reconstruit sur la base d’un compromis global incluant la Russie, mais façonné par une succession de décisions unilatérales, conçues et mises en œuvre dans un cadre intellectuel largement occidentalo-centré. Pour Moscou, cette dynamique installe progressivement l’impression d’être reléguée en périphérie d’un système dont elle n’est plus partie prenante, mais seulement l’objet.
L’élargissement de l’OTAN : une ligne rouge ignorée
Dès les années 1990, les élargissements successifs de l’OTAN aux pays d’Europe centrale et orientale font naître à Moscou un sentiment croissant de méfiance. Les dirigeants russes avaient espéré être associés à la construction d’un cadre de sécurité paneuropéen, mais constatèrent au contraire que le bloc politico-militaire occidental avance progressivement jusqu’à leurs frontières. Pour le Kremlin, cette dynamique traduit une contradiction entre les discours de partenariat affichés par Washington et les décisions stratégiques irréversibles prises par l’Alliance.
Les travaux de Mary Élise Sarotte montrent que cette expansion n’est pas le produit d’un glissement involontaire, mais d’une série d’arbitrages délibérés opérés à Washington dans un contexte géopolitique où la Russie, affaiblie politiquement et économiquement, ne disposait plus des moyens d’influer sur la trajectoire occidentale[14]. En février 1990, lors d’un échange resté célèbre, le secrétaire d’État américain James Baker déclarait à Mikhaïl Gorbatchev que l’OTAN ne s’étendrait pas d’un pouce vers l’Est (« not one inch eastward » sa « jurisdiction »)[15] — une assurance verbale que l’administration Bush abandonne dès le lendemain, considérant qu’elle restreindrait trop la liberté d’action de l’Alliance.
Dans les années 1990, l’administration Clinton renforce cette orientation : consciente de la vulnérabilité économique aiguë de la Russie, dépendante du FMI et en proie au chaos intérieur, elle exploite cette faiblesse pour obtenir l’acquiescement minimal de Moscou à chaque étape de l’élargissement. Parallèlement, Washington cantonne la Russie à des mécanismes consultatifs dépourvus de pouvoir de codécision — tel le Partenariat pour la paix (1994) ou le Conseil OTAN-Russie (1997) — qui donnent l’apparence d’une architecture inclusive sans en modifier les fondements[16].
Les réserves françaises et allemandes, pourtant récurrentes, ne parviennent pas à infléchir la trajectoire américaine. Paris et Berlin plaident à plusieurs reprises pour une architecture de sécurité paneuropéenne fondée sur la CSCE et OSCE ou pour une limitation de l’élargissement, mais ces positions sont marginalisées[17]. Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, affirmera publiquement à plusieurs reprises, des années plus tard, que des engagements verbaux de non-élargissement ont été évoqués devant Mikhaïl Gorbatchev en présence de François Mitterrand, Helmut Kohl et Margaret Thatcher[18]. Mary Élise Sarotte ne cite pas ces déclarations tardives, mais ses travaux confirment que la France défendait en 1989-1990 une approche fondée sur la limitation de l’extension de l’OTAN et la construction d’un cadre paneuropéen plus inclusif.
À cette dynamique s’ajoute la pression constante des États d’Europe centrale et orientale. Marqués par l’héritage soviétique, Varsovie, Prague, Budapest, puis les États baltes mènent une diplomatie active auprès de Washington pour obtenir une adhésion pleine et rapide à l’OTAN. Leur action contribue à verrouiller une logique binaire : appartenir à l’Alliance, ou rester dans une zone grise perçue comme vulnérable[19]. Sarotte souligne que cet activisme a joué un rôle déterminant dans la décision américaine de considérer comme « inacceptables » les modèles intermédiaires ou les statuts associés proposés dans un premier temps[20].
Le sommet de Bucarest de 2008 marque une rupture majeure : l’Alliance affirme que l’Ukraine et la Géorgie « deviendront membres de l’OTAN ». Un an plus tôt, Vladimir Poutine avait déclaré à Munich que cette perspective était « absolument inacceptable » pour la Russie[21]. Le passage d’un espace historiquement considéré comme glacis stratégique à une zone promise à une alliance militaire adverse est interprété par Moscou comme la confirmation d’une dynamique ignorant ses préoccupations de sécurité.
Enfin, les propositions russes visant à réviser ou à refonder les mécanismes européens de sécurité — notamment le projet de traité présenté par Dmitri Medvedev en 2009 — demeurent sans suite[22]. Pour le Kremlin, cela confirme que ses intérêts fondamentaux ne sont ni reconnus ni intégrés dans l’architecture stratégique occidentale.
La défense antimissile américaine : une crainte structurelle pour Moscou
À cette première source de tension s’ajoute la mise en œuvre par les États-Unis, dès 2009, de l’« European Phased Adaptive Approach » (EPAA), destiné à déployer des intercepteurs SM-3 en mer et à terre. Le dispositif est officiellement conçu pour contrer une menace balistique venant du Moyen-Orient, en particulier de l’Iran.[23]
En mai 2016, le site Aegis Ashore de Deveselu, en Roumanie, devient pleinement opérationnel selon l’OTAN et le commandement américain.[24] Un second site est en construction en Pologne. La particularité de ces installations tient aux lanceurs verticaux Mk-41, capables — du point de vue technique — de tirer non seulement des intercepteurs, mais aussi des missiles de croisière Tomahawk, même si Washington affirme ne pas en déployer.
Dans la rhétorique russe, ces capacités duales représentent une menace directe pour la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe[25]. Juridiquement, rien ne justifie une riposte militaire contre un système de défense, fût-il jugé déstabilisant. Mais stratégiquement, l’élargissement de l’OTAN conjugué à la réalisation du bouclier antimissile alimente chez les élites militaires russes la crainte d’être placées dans une position de vulnérabilité structurelle.
Soutiens politiques clandestins, accompagnement militaire et renseignement : l’action continue des services anglo-saxons.
Toute analyse honnête des responsabilités géopolitiques occidentales doit intégrer un troisième facteur, souvent occulté : le rôle actif et durable des services américains (CIA) et britanniques (MI6) dans l’évolution politique et militaire de l’Ukraine au cours des deux dernières décennies.
Révolutions de couleur : soutien américain documenté
Dès les premières « révolutions de couleur » — Géorgie 2003, Ukraine 2004, Kirghizstan 2005 —, des sources officielles reconnaissent un soutien actif de Washington. Condoleezza Rice déclara en 2005 que les États-Unis avaient « œuvré pour que la démocratie prenne racine dans l’espace postsoviétique », en soutenant les forces pro-occidentale[26]. Le Washington Post révéla que les États-Unis avaient dépensé plus de 41 millions de dollars pour soutenir des organisations politiques pro-occidentales en Ukraine avant 2004[27]. Ces initiatives, présentées comme un appui à la « société civile », eurent pour effet concret de remodeler l’espace postsoviétique au profit des intérêts euro-atlantiques.
Maidan : implication des réseaux diplomatiques et de renseignement
Les événements de Maidan (2013–2014) n’échappent pas à cette logique. L’appel téléphonique — authentifié par le Département d’État — entre Victoria Nuland et l’ambassadeur Geoffrey Pyatt révèle que Washington discutait explicitement de la composition du futur gouvernement ukrainien[28]. Victoria Nuland affirma également publiquement que les États-Unis avaient investi plus de 5 milliards de dollars en Ukraine depuis 1991 pour « soutenir les institutions démocratiques »[29].
Formation militaire de l’Ukraine avant 2014
Bien avant l’annexion de la Crimée, des programmes de formation militaire étaient déjà en place. Selon un rapport officiel du Congressional Research Service, les forces spéciales américaines entraînent des unités ukrainiennes au moins depuis 2007[30]. L’ancien conseiller du Pentagone, Michael Carpenter, confirme que ces programmes visaient explicitement à accélérer « l’intégration de l’Ukraine dans les structures de sécurité occidentales »[31].
Coopération de renseignement et opérations clandestines
Plusieurs sources indiquent que la coopération de renseignement entre Washington et Kiev débute avant 2014. L’Arms Control Association évoque des coopérations en matière de surveillance et d’échange d’informations « dès 2010 »[32]. The Intercept confirme, de son côté, que la CIA « maintenait une présence en Ukraine depuis des années, bien avant la crise criméenne »[33]. Selon le Royal United Services Institute, le MI6 participe depuis longtemps à la formation des services de sécurité ukrainiens[34]. Le journaliste Luke Harding (The Guardian) a également décrit des opérations d’information britanniques pendant Maidan[35].
Bien avant 2014, l’État ukrainien n’était plus un acteur neutre. Il était devenu un partenaire militaire et politique avancé des États-Unis et du Royaume-Uni, au point que Moscou percevait son armée et ses élites comme intégrées à un dispositif occidental d’endiguement. Au regard du droit international, cela ne délégitime en rien l’agression russe ; cela explique toutefois pourquoi, dans la perspective du Kremlin, la « neutralité stratégique » ukrainienne semblait depuis longtemps une fiction.
On parvient ainsi à un constat sans appel : l’Occident, soumis à l’influence néoconservatrice de la stratégie étatsunienne en en multipliant les attitudes agressives vis-à-vis de la Russie, en ignorant délibérément les lignes rouges fixées par Moscou, a sciemment poussé les dirigeants russes à la faute au regard du droit international.
Conclusion générale
La guerre en Ukraine échappe aux schémas manichéens qui voudraient désigner d’un côté un agresseur intrinsèquement coupable et, de l’autre, un Occident irréprochable, réduit à un rôle de spectateur indigné. Il serait tout aussi abusif, à l’inverse, de présenter les États-Unis et l’Europe comme les seuls artisans du désastre, reléguant la Russie au rang d’acteur simplement acculé. La réalité impose davantage de nuances et davantage de lucidité.
Sur le strict terrain du droit international, la conclusion ne souffre aucune ambiguïté : la Russie est l’agresseur dès 2014. Ni l’élargissement de l’OTAN, ni le déploiement américain de systèmes antimissiles, ni les révolutions de couleur ne constituent, en droit, des motifs recevables pour agresser un État souverain. Mais, la dernière partie de notre analyse montre clairement que les administrations américaines, depuis l’effondrement de l’URSS dans leur hubris dominatrice et leur volonté de réduire la nouvelle Russie à l’impuissance stratégique, l’ont sciemment poussée à l’acte. Ils l’ont d’autant plus été qu’ils ont été appuyés par les pays de l’Europe centrale et orientale d’une part, et le manque de courage politique de pays de l’Europe occidentale, en particulier, de l’Allemagne et de la France, qui ont abandonné leur rôle modérateur et de garant de la paix. A ce titre, comme, le dit François-Auguste Mignet, ils peuvent et doivent être considérés comme les principaux responsables de ce conflit. Certains peuvent penser que rien ne justifie l’attaque d’un pays souverain par les dirigeants du Kremlin, mais tout le monde doit admettre la responsabilité des dirigeants américains et européens, ou même leur culpabilité, dans l’instigation de ce conflit.
Cette vérité n’en annule pas une autre. Les puissances occidentales qui s’érigent aujourd’hui en gardiennes de la légalité internationale n’ont pas toujours respecté ce même droit lorsqu’il contrariait leurs intérêts : comme l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999 sans mandat du Conseil de sécurité, ou encore l’invasion américaine de l’Irak en 2003 fondée sur des motifs fallacieux, opérations extérieures menées en Afrique dans des cadres juridiques approximatifs. Ces précédents, largement assumés politiquement, ont contribué à délégitimer l’idée d’un droit universel, égalitaire, contraignant pour tous. Ils ont installé un précédent implicite : celui d’un droit appliqué selon le rapport de forces.
En rompant ouvertement cet ordre en 2014 puis en 2022, la Russie n’a fait qu’adopter — brutalement, mais dans la continuité d’une position affirmée et jamais démentie — une logique que d’autres avaient déjà mise en œuvre. Ce constat n’excuse rien : il rappelle seulement que le droit international est trop souvent façonné par les puissants, et que l’on juge volontiers l’adversaire à l’aune de principes que l’on s’applique rarement à soi-même.
Si l’Europe souhaite reconstruire une architecture de sécurité durable, elle devra commencer par reconnaître cette contradiction fondamentale. La paix ne pourra se bâtir sur l’illusion d’une innocence unilatérale ni sur la perpétuation d’un droit sélectif ; elle exigera un ordre où la règle ne soit plus l’instrument du plus fort, mais la garantie de tous. C’est à cette condition, et à cette condition seulement, que pourra s’imaginer un avenir où l’Ukraine, la Russie et l’Europe ne seront plus condamnées à répéter les erreurs qui ont nourri la tragédie présente. Ce n’est visiblement pas l’intention des dirigeants de l’UE qui, plutôt que d’être les moteurs dans une démarche de négociation en faveur d’une paix rapide et durable, n’ont de cesse de développer médiatiquement un discours belliciste. Bien sûr, l’Europe et la France doivent renforcer leur défense et leur sécurité. Cependant, il ne devrait y avoir aucun obstacle à ce que nos dirigeants mettent fin à ce conflit en envisageant de rétablir une relation de partenariat avec la Russie. Il est crucial de mettre fin à la marginalisation et à la démonisation de cette puissance mondiale et de ses responsables. Les nôtres en auront-ils la lucidité ?
Colonel (h) Jean-Jacques Bénomard
[1] United Nations General Assembly, Territorial Integrity of Ukraine, Resolution 68/262, March 27, 2014
[2]“Igor Girkin,” Wikipedia, consulted November 2025 (section on the seizure of Sloviansk and his admission of responsibility).
[3] Anna Dolgov, “Russia’s Igor Strelkov: I Am Responsible for War in Eastern Ukraine,” The Moscow Times, November 21, 2014.
[4] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in Ukraine from 16 February to 15 May 2016 (et séries de rapports 2014–2016).
[5] Atlantic Council, Hiding in Plain Sight: Putin’s War in Ukraine, report, October 2015
[6] International Partnership for Human Rights et al., Where Did the Shells Come From? Investigation of Cross-Border Attacks in Eastern Ukraine, June 2016.
[7] 2014 Russian Cross-Border Shelling of Ukraine” et « Zelenopillia Rocket Attack, » Wikipedia, consulté en novembre 2025.
[8] Human Rights Watch, “Ukraine: Widespread Use of Cluster Munitions,” October 20, 2014.
[9] Human Rights Watch, “Ukraine: Rising Civilian Toll in Luhansk,” September 1, 2014.
[10] Amnesty International, Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine, EUR 50/1683/2015, May 2015.
[11] Amnesty International et Human Rights Watch, « You Don’t Exist » : Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, July 2016.
[12] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016 (et séries de rapports 2014–2016).
[13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN report on 2014–16 killings in Ukraine highlights ‘rampant impunity’,” press release, July 14, 2016; et “Civilians in Ukraine continue to suffer – UN report,” December 8, 2016.
[14] Mary Elise Sarotte, Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post–Cold War Stalemate (New Haven: Yale University Press, 2021), chap. 1–2
[15] “Memcon: Baker–Gorbachev, February 9, 1990,” U.S. National Security Archive; cité dans Sarotte, Not One Inch, 112.
[16] Ibid., 203–240
[17] Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification allemande (Paris : Odile Jacob, 2005), 245–272.
[18] Entretiens de Roland Dumas (2014–2015). Pour la position française de l’époque, voir Bozo, Mitterrand, 259–268
[19] Sarotte, Not One Inch, 234–240
[20] H-Diplo Roundtable Review 14–26, “Review of Not One Inch,” 2022.
[21] Vladimir Putin, « Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy, » 10 February 2007
[22] Dmitri Medvedev, « European Security Treaty Proposal, » Kremlin Archives, 2009
[23] Arms Control Association, “U.S. Missile Defense Policy: European Phased Adaptive Approach,” 2014 (armscontrol.org+4OTAN+4armscontrol.org+4)
[24] U S. European Command (EUCOM), “Aegis Ashore Romania Declared Operational,” 2016
[25] “Aegis Ashore,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, consulté 2024.
[26] Condoleezza Rice, Statement before the Senate Foreign Relations Committee, 20 April 2005
[27] The Washington Post, “U.S. Spent $41 Million on Ukrainian Democracy Programs,” 11 December 2004.
[28] BBC News, “Ukraine Crisis: Transcript of Leaked Nuland-Pyatt Call,” 2014
[29] Victoria Nuland, Speech to the U.S.-Ukraine Foundation, 13 December 2013
[30] Congressional Research Service, U.S. Security Assistance to Ukraine, 2015
[31] “Britain’s Secret Role in the Maidan Crisis,” The Guardian, 2015
[32] Arms Control Association, « U.S.-Ukraine Security Cooperation, » 2015
[33] The Intercept, “CIA Operations in Eastern Europe,” 2016
[34] Royal United Services Institute (RUSI), UK–Ukraine Defence Cooperation, 2015.
[35] Luke Harding, “Britain’s Secret Role in the Maidan Crisis,” The Guardian, 2015







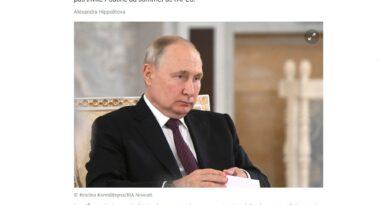
” Sur le strict terrain du droit international, la conclusion ne souffre aucune ambiguïté : la Russie est l’agresseur dès 2014. ”
” Le Droit international ” derrière lequel vous vous drapez signifiait donc qu’il fallait laisser le Donbass séparatiste se faire envahir par les soudards d’Azov, entre autres braves ” soldats ” ukrainiens, et tel qu’il était prévu par Kiev de façon imminente (troupes massées et avérées aux frontières de la région, à l’hiver 2022), d’où l’intervention russe, après 8 (HUIT !) années de bombardements CIVILS de la part de l’OTAN heu… de l’Ukraine.
Hé bien, cela signifie donc que ” le Droit international ” dont vous vous gargarisez dans ce pensum est une escroquerie. Ce qui est une évidence pour toute personne qui s’est penchés sur la géopolitique depuis ces dernières décennies. En effet, quand les deux pays voyous et terroristes que sont les États-Unis et Israël font ce qu’ils veulent depuis + ou – 70 années, en s’assayant sur les résolutions de l’ONU, c’est que ledit ” Droit international ” est :
– soit une esbrouffe
– soit taillé pour eux.
Quoi d’autre ?
Dès lors, votre prose est à mettre à la poubelle, car de parti-pris. Et même pire, car teinte d’une fameuse dose d’hypocrisie qui ne vous fait pas honneur, ” mon général “.
Bien à vous.
Bonjour,
Vous omettez volontairement le point fondamental : en 2014, Porochenko proclame l’interdiction de l’usage de la langue russe dans tout l’Ukraine. Alors que les habitants du Donbass ne parlent que cette langue… Bien sûr ils se rebellent. Inévitable.
Toutes vos circonvolutions autour du “Droit International ” ne changent rien à cette décision stupide qui est la seule vraie cause du départ de la guerre.
Cela rend votre “démonstration” assimilable à de la pure propagande, dans laquelle toutes les parties en cause se complaisent. Je ne vous félicite pas. Sorry