Ukraine: une guerre non provoquée, vraiment? (partie 1)
Pourquoi Joe Biden avait-il tellement besoin d’une guerre en Europe centrale ? Voila une question incongrue.
Dans la guerre d’Ukraine, il y a un agresseur et un agressé.
C’est la formule imprimée dans l’écrasante majorité des cerveaux sur les deux rives de l’Atlantique nord.
L’image des troupes russes pénétrant en Ukraine le 24 février 2022, par le Nord, le Sud et l’Est, en fait une vérité irréfutable. C’est aussi l’argument principal qui légitime, coté occidental, de répondre à cette « invasion injustifiée et non-provoquée » par des sanctions inédites, par la mise au ban des nations, et demain par « une défaite stratégique ».
L’opération militaire russe a-t-elle surgi du néant ou a-t-elle un passé ? Était-elle vraiment non provoquée ? Tout est là. Quand on pense la guerre en cours, il suffit d’ouvrir le champ de la lunette pour que le tableau se complique et que la pensée binaire peine à rendre la réalité. Or, comprendre l’engrenage qui a mené en un an d’escalade au seuil d’un face à face direct entre les puissances nucléaires majeures de l’époque impose d’aller au-delà des écrans de fumée de la communication de guerre.
C’est pourquoi il faut identifier objectivement les motifs et les attentes des principaux protagonistes que sont la Russie et les États-Unis, à partir des invariants de leur doctrine stratégique.
Comment les Russes expliquent-ils leur opération militaire spéciale ?
Parmi les « lignes rouges » et les mises en garde du régime russe à l’endroit des Occidentaux, on retient quatre motifs susceptibles de pousser les Russes à entrer en Ukraine le 24 février 2022 :
1) D’abord, Moscou avance le motif d’assistance aux populations des républiques de Donetsk et de Lougansk visées par une offensive imminente. Ce fût pour eux l’urgence principale. L’armée de Kiev est alors concentrée dans le Donbass depuis des semaines. Dès le 15 février ses bombardements de plus en plus intenses sont dûment enregistrés par l’OSCE. Il y a sur place des unités d’infanterie, de blindés, d’artillerie et de génie prêtes au combat. Deux offensives du même genre, impliquant aviation, chars, et infanterie, avaient été lancées par le régime en 2014 et au début de 2015. En février 2022, la suite naturelle de l’écrasement des deux républiques serait suivie par la conquête de la Crimée, porte d’entrée de la Russie dans les mers chaudes, annexée en 2014.
2) A partir de là, Kiev substitue une opération militaire à la solution coopérative de Minsk (2014/2015). Le règlement négocié entre les autonomistes et le gouvernement sous le nom d’accords de Minsk a été ratifié par le Conseil de Sécurité de l’ONU. Il stipule que des éléments d’autonomie culturelle et linguistique seront accordés aux populations du Donbass, au sein de l’Ukraine, moyennant une réforme de la constitution ukrainienne. Tout vient d’une loi adoptée par la Rada le lendemain du coup de Maïdan de février 2014, proscrivant l’usage du russe dans l’administration et l’enseignement.
Ainsi les autonomistes russophones auraient leur place en Ukraine, préservant l’unité politique et territoriale du pays. Les parties signataires de l’accord étaient les autonomistes et le gouvernement de Kiev ; la Russie, la France et l’Allemagne en étant les garants. Comme l’ont déclaré publiquement, Mme Merkel, M. Hollande, le président ukrainien de l’époque Petro Porochenko et l’actuel Volodimir Zelensky, pour les Occidentaux comme pour Kiev, il n’a jamais été question d’appliquer ces textes pourtant exécutoires après leur validation par l’ONU. La négociation de Minsk avait en fait servi à bloquer l’offensive victorieuse des autonomistes en 2015 et à donner du temps à Kiev pour préparer une armée en mesure de régler par les armes le problème du Donbass.
Mi-février 2022, une fois la dernière offensive ukrainienne déclenchée, la Russie a beaucoup hésité avant de décider que cette fois, elle ne pouvait pas ne pas intervenir militairement pour protéger les Russes de souche et sauvegarder son contrôle sur la Crimée. La solution juridique consista à reconnaitre l’indépendance des deux républiques et de passer avec elles un traité d’assistance justifiant l’intervention russe.
3) Le troisième motif de l’entrée en guerre des forces russes est le refus catégorique de Moscou de voir s’installer un État hostile membre de l’OTAN – l’Ukraine – à sa frontière la plus sensible. Cet État pourrait, comme en Roumanie et en Pologne, abriter des bases américaines de missiles capables de frapper Moscou en quelques minutes. En effet, Washington a déjà implanté en Roumanie et en Pologne, dans le cadre de l’OTAN, des systèmes mixtes de missiles anti-missiles et de missiles de croisière possiblement nucléaires (Aegis Ashore sur lanceurs Mk 41). Ces engins mettraient actuellement une trentaine de minutes pour frapper Moscou et l’arsenal stratégique russe. Implantés à Kharkov, sur des lanceurs hypersoniques, le délai serait réduit à 5 à 7 minutes. Moscou n’aurait pas le temps de distinguer entre missiles anti-missiles et missiles de croisière nucléaires. Tous les mécanismes de la dissuasion seraient alors annulés, ne laissant pas aux Russes d’autre choix que la contre-frappe nucléaire. Par ailleurs les missiles de « décapitation » américains dédiés aux cibles humaines, les États-majors politiques et militaires, devraient figurer dans la panoplie déployée sur les bases otaniennes, accroissant encore la vulnérabilité de la Russie.
4) C’est pour cela qu’elle a tant réclamé à la nouvelle administration Biden, dès son installation, la négociation d’un accord global sur l’architecture de sécurité européenne. Il fallait combler les failles béantes du dispositif actuel. Biden leur a systématiquement opposé des refus ou des réponses dilatoires. Le 17 décembre 2021, les Russes ont proposé non plus une conférence mais deux traités dûment rédigés pour ouvrir enfin le débat. Ils ont été écartés d’un coup de plumeau fin-janvier.
Dans le tableau de l’immédiat avant-guerre, il faut aussi prendre en compte les facteurs psychologiques. Selon l’historienne Annie Lacroix-Riz, l’Ukraine représente pour les Russes, ce qu’est non pas l’Alsace-Lorraine mais l’Île-de-France pour les Français. La voir devenir un pays radicalement hostile et le tremplin d’une agression possible était pour eux intolérable, et cela a sans doute contribué indirectement à convaincre Poutine de franchir le Rubicon.
L’extension de l’OTAN n’était pas en soi un motif de guerre pour le Kremlin. Les Russes distinguent dans ce qui fut le glacis de l’union soviétique, les anciens pays du Pacte de Varsovie et les pays issus de l’explosion de l’Union soviétique en 1991, plus proches d’eux. Et parmi ces ex-membres de l’Union soviétique, ils sont particulièrement attentifs aux politiques des pays ayant fait partie de l’ex-empire tsariste, entrés dans l’Union dès le début des années 20, qui se sont séparés en 1991. Ce sont l’Ukraine, le Belarus et la Géorgie, les tampons stratégiques de l’ouest et du sud-ouest du pays. Pour la Russie, l’entrée de la Roumanie ou de la Pologne dans l’OTAN est une chose, celle de l’Ukraine ou de la Géorgie en est une autre.
La volonté américaine d’intégrer l’Ukraine et la Géorgie dans l’OTAN dès 2008 était donc vécue comme très hautement provocatrice ; les Américains le savaient parfaitement. les Français et les Allemands aussi, et c’est pour cela que Merkel et Sarkozy avaient obtenu à ce moment-là de retarder leur adhésion.
La question de la sécurité européenne et celle des missiles anti-missiles ne pouvait se traiter aux yeux du Kremlin autrement que par des négociations. Mais le refus net de la nouvelle administration américaine créait un climat de tension extrêmement élevé. Du point de vue russe, les choses ne pouvaient en rester là. D’autant que depuis 2001 les États-Unis se retiraient des principaux traités internationaux de limitation des armements ABM, Open Skies, INF, portant sur les missiles, les anti-missiles et les têtes nucléaires. L’architecture du désarmement élaboré progressivement dès 1968, était démantelée. Seul demeurait valide jusqu’en 2026 le traité New Start. Il a été suspendu par la Russie le 21 février 2023 car les États-Unis demandaient à inspecter l’arsenal nucléaire russe (conformément aux termes du traité) sauf qu’ils avaient eux-mêmes précédemment refusé à la Russie une inspection de même nature.
Par ailleurs, il ne faut pas considérer que « la démilitarisation et la dénazification » de l’Ukraine, présentées comme un objectif important coté russe, soient la cause de l’intervention russe. Ce sont davantage des objectifs donnés à une intervention décidée pour des motifs autres, visant à mettre un terme définitif à l’hostilité des gouvernements de Kiev.
En fin de compte, au cœur de la décision russe d’intervention, il y avait l’impératif de préserver l’existence des républiques autonomistes et de prévenir une catastrophe humanitaire. Le canon était en train de tonner, cela ne pouvait pas attendre. Pour Poutine, tout le reste du contentieux devait viser le compromis et rester dans la sphère de la diplomatie.
Les véritables obsessions de Poutine étaient d’ordre intérieur : la natalité en Russie, la modernisation accélérée du pays, son intégration dans le marché mondial, et sa sécurité. La réussite de son programme était conditionnée par le maintien de la paix. Personne n’a jamais apporté des preuves de sa supposée volonté d’expansion impériale. Ce qui ne signifiait pas l’immobilisme. Les péripéties de la vie internationale imposent à un acteur influent de jouer un rôle dans les conflits en cours, en particulier dans son voisinage, en Syrie ou en Libye, dont Washington s’acharnait à changer les régimes. Cela signifie défendre des intérêts et non pas conquérir ou annexer. Depuis 2007, la Russie a refusé clairement de s’aligner sur Washington et elle a essuyé en retour pressions, vexations et provocations. Exprimer une volonté indépendante n’est considéré comme impérialiste que par les Etats-Unis qui ne souffrent pas la contestation de leur hégémonie.
Il faut comprendre pourquoi le degré d’antagonisme américano-russe s’est régulièrement élevé à partir de cette date, au point de déboucher sur le très périlleux face à face actuel.
Comment les Américains perçoivent l’essor de la Russie et leur rôle en Eurasie
L’argumentaire officiel qui justifie l’implication des États-Unis dans la guerre d’Ukraine peut se résumer en quelques points :
- La solidarité des États-Unis doit aller au petit État soumis à une agression « injustifiée et non provoquée », qui bafoue ses droits souverains inscrits dans la Charte des Nations Unies ;
- Si on laissait la Russie régler militairement ses différends avec ses voisins, la sécurité de toute l’Europe serait compromise par les ambitions de Poutine, qui rêve de restaurer l’ancienne l’Union soviétique ou l’empire tsariste du 19ème siècle ;
- Laisser impunie l’agression russe compromettrait « l’ordre international libéral fondé sur des règles », aujourd’hui garanti par le leadership actif des États-Unis au service du monde libéral. L’époque actuelle serait caractérisée par un affrontement entre « démocraties et autocraties », la capitulation des démocraties en Ukraine étant hors de question.
Les deux premières explications américaines sont exclusivement polémiques. L’ambition impériale actuelle de la Russie est un mythe, ses options politiques et diplomatiques prudentes, comme les évaluations des renseignements, en attestent. Elle n’a ni l’intention ni les moyens de s’attaquer aux pays européens mais l’ambition de multiplier avec eux les échanges, les investissements et les projets de toute nature. Tous le savent.
Par ailleurs investir dans la guerre d’Ukraine près de 150 milliards de $ en un an, et prendre le risque d’une guerre contre la Russie, ne peut pas avoir pour seul motif la protection de l’intégrité d’un pays d’importance stratégique secondaire pour les Etats-Unis. Le prétendre est une fable.
L’Amérique n’a pas la religion de la paix, loin de là. Elle est n’est restée en paix que 20 ans en 240 ans d’existence. Elle a mordu à pleine dents dans la chair des « petits », Panama, La Grenade, Saint Domingue, Cuba, le Guatemala … la liste est longue… jusqu’à la déposition du président Pedro Castillo au Pérou en décembre dernier.
Pour remettre la réalité des calculs américains sur ses pieds, on citera Barack Obama, qui s’exprimait en 2016 dans une interview bilan de ses deux mandats pour The Atlantic « S’il y a quelqu’un dans cette ville qui prétend que nous envisagerions d’entrer en guerre avec la Russie pour la Crimée et l’Ukraine orientale, il devrait s’exprimer et être très clair à ce sujet. »
Obama veut dire que seul un original pourrait avoir l’idée saugrenue d’un tel conflit. Et peut-être aussi que son second dans la hiérarchie de la Maison Blanche, en charge du dossier de l’Ukraine, Joseph Robinette Biden, est un homme dangereux.
On accuse Poutine d’agressivité à cause de son intervention militaire contre le président géorgien Saakachvili en 2008. Mais il réagissait à son initiative de bombarder l’Ossétie du Sud faisant plusieurs milliers de morts. Déjà la Russie réagissait à une guerre contre des populations russophones à sa frontière. Accusé de passivité, Obama répondait : « Poutine est allé en Géorgie sous le regard de Bush, en plein milieu de la période où nous avions plus de 100.000 soldats déployés en Irak. » Il trouve peut-être ridicule que l’on joue au bon Samaritain avec un couteau entre les dents, ou qu’il n’est pas habile de guerroyer sur deux fronts en même temps. En tout état de cause, l’Amérique, avec ses 800 bases militaires à l’étranger son budget de défense himalayen, est mal placée pour donner de leçons de pacifisme, que ce soit en l’Ukraine ou ailleurs.
Par contre, la troisième explication de l’implication des États-Unis dans le conflit d’Ukraine, comme défenseur de « l’ordre international libéral fondé sur des règles », renvoie à une doctrine dominante depuis Reagan au sein des élites du pouvoir. Replacée dans la conjoncture stratégique du mandat de Joe Biden, elle donne une interprétation plus plausible des risques que prend actuellement la Maison Blanche en Europe centrale.
1) La vision stratégique américaine en politique extérieure
La perception de l’Amérique sur sa place dans le monde après l’effondrement de l’Union soviétique a été présentée de façon synthétique en 1997 par Zbigniew Brzezinski dans son fameux « Le Grand Échiquier ».
Pour l’Amérique dit-il, « l’enjeu principal est l’Eurasie. Et pour la première fois, c’est une puissance extérieure [l’Amérique] qui prévaut en Eurasie… cette situation n’aura qu’un temps. Mais de sa durée et de son issue dépendent non seulement le bien être des États-Unis mais la paix dans le monde. » Brzezinski recommande donc de refuser aussi bien « le repli intérieur » que « l’apparition d’un rival ». D’autant que l’hégémonie américaine est superficielle. « Elle s’exerce par de multiples mécanismes d’influence, mais à la différence des empires du passé, pas par le contrôle direct. »
On peut résumer à partir de ces minces extraits le solide consensus des élites du pouvoir américaines :
- Perpétuer la domination des États-Unis sur l’Eurasie, donc sur la planète, est le but supérieur de la politique étrangère américaine ;
- Prévenir activement l’émergence d’un rival, c’est-à-dire d’une puissance concurrente (on pense à la Russie et à la Chine) ;
- Maintenir, sinon renforcer, la force d’influence américaine sur l’Eurasie, clé de la pérennité du monde unipolaire.
Brzezinski plaide ici pour que les Etats-Unis demeurent le pôle de puissance unique qu’ils sont devenus depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Ce courant est ultra-majoritaire au sein des élites US.
Face à lui, il n’y a que de rares conservateurs authentiques, obsédés par les risques de l’État-Léviathan et le niveau de la fiscalité. Ils n’aiment pas les dépenses militaires, terreau de l’impôt, ni les interventions extérieures qui s’achèvent en « guerres éternelles ». America first.
Pour les hégémonistes, le devoir c’est de tenir à l’œil les rivaux qui pointent l’oreille, la Chine, la Russie, mais aussi l’Allemagne dont les performances industrielles donnent des maux de tête à la Maison Blanche. Ils savent qu’il leur faut en priorité maintenir voire développer l’influence/emprise sur leurs points d’appui : les Européen à l’ouest de l’Eurasie et à l’autre extrémité, les alliés de longue date dans l’aire indo-pacifique (Taïwan, Japon, Australie, Corée du Sud, Philippines).
Sur les modalités de l’hégémonie (diplomatie, économie, guerre), les opinions divergent. Paul Wolfowitz, icone du néoconservatisme et architecte de la guerre en Irak de 2003, insistera sur l’élimination des rivaux potentiels avant qu’ils ne soient trop forts, sans exclure la guerre préventive. Aujourd’hui, Robert Kagan, l’un des auteurs vivants les plus prolifiques de ce courant, théorise cette option sans mettre de gants.
A travers une interprétation personnelle de l’histoire des États-Unis des deux derniers siècles, Kagan développe la dualité entre « les guerres nécessaires » et « les guerres choisies ». La guerre nécessaire est la guerre pour la survie ; elle se situe au niveau des besoins primaires, quand un agresseur risque de conquérir le territoire national et de détruire les institutions en place. Pour lui, l’Amérique n’a jamais mené de « guerre nécessaire. » Même après Pearl Harbor les Japonais n’étaient pas une menace car ils n’imaginaient pas envahir l’Amérique, pas plus que Hitler malgré sa déclaration de guerre. Les États-Unis ont donc toujours fait des « guerres choisies » c’est-à-dire les guerres qu’ils ont voulu mener, sans avoir à traiter une menace directe pour leur existence. S’ils ont combattu, c’est pour façonner l’ordre international au gré de leurs intérêts et de leur hégémonie. D’où leur conviction d’être les seuls garants de l’ordre international libéral dans le monde.
Mieux, les États-Unis ont poussé leurs adversaires à déclencher des guerres qu’ils souhaitaient. Kagan est très clair : « [Les Américains] oublient les politiques américaines qui ont conduit les Japonais à attaquer Pearl Harbor et qui ont amené Hitler à déclarer la guerre ». La charge est inversée. C’est l’Amérique qui veut la guerre mais elle charge l’ennemi de la déclencher et d’en subir l’opprobre.
Cependant Kagan est mécontent des décisions des gouvernements de son pays. Il leur reproche d’avoir toujours trop attendu avant d’intervenir militairement, et d’avoir permis à leurs ennemis de prendre des forces et de s’affirmer alors qu’il eut été plus facile et moins couteux de s’en débarrasser au tout début de leur ascension. Sparte aurait dû attaquer Athènes bien plus tôt. Désormais, « …la question est de savoir si les États-Unis continueront à commettre leurs propres erreurs ou s’ils apprendront, une fois de plus, qu’il vaut mieux contenir les autocraties agressives à un stade précoce, avant qu’elles n’aient pris de l’ampleur et que le prix à payer pour les arrêter augmente. »
C’est là que se situe une divergence capitale entre les théoriciens hégémonistes de la politique internationale américaine. Ils se divisent entre « réalistes » et « interventionnistes » ou néoconservateurs. Les réalistes, aussi sensibles que les interventionnistes aux intérêts unipolaires des États-Unis, sont plus prudents. Ils mettent en garde contre les inconvénients des interventions extérieures en série ; elles sont très couteuses et il faut dépenser l’aide aux pays frappés. Elles peuvent générer des conflits en cascade, et leur parfum impérialiste entache l’image de l’Amérique. Finalement, les États-Unis ont une capacité d’intervention qui a ses limites. En témoignent les « guerres éternelles » en Afghanistan, en Irak, au Yémen, qui sont le legs amer des néocons.
De ce fait, des réalistes peu amènes envers la Russie comme Barack Obama, ont toujours mis en garde contre l’intervention des États-Unis en Ukraine. Ils soulignent que ce sujet est hyper sensible pour les Russes qui n’hésiteront pas à faire la guerre, avec de grands risque pour les États-Unis. C’est leur avertissement solennel, de Georges Kennan à Henry Kissinger, à Zbigniew Brzezinsky lui-même, et aux plus grandes figures de la guerre froide contre l’Union soviétique. C’est aujourd’hui la mise en garde de John Mearsheimer entre autres, et mezzo voce de l’armée via son chef d’état-major général, Mark Milley, sans oublier la Rand Corporation, le think tank du Département d’État.
Mais aujourd’hui, pour les interventionnistes bien représentés par Robert Kagan, foin de l’équilibre des forces, foin des conférences diplomatiques, foin de quatre siècles d’influence des Russes. Dans le cas de l’Ukraine, on a trop attendu. « [les Américains] se sont à nouveau mobilisés pour défendre le monde libéral. Il aurait été préférable qu’ils le soient plus tôt. Poutine a passé des années à sonder ce que les Américains toléreraient, d’abord en Géorgie en 2008, puis en Crimée en 2014, tout en renforçant sa capacité militaire (pas bien, comme il s’avère). La réaction prudente des Américains à ces deux opérations militaires, ainsi qu’aux actions militaires russes en Syrie, l’a convaincu d’aller de l’avant. Sommes-nous mieux lotis aujourd’hui pour ne pas avoir pris les risques à l’époque ? »
Biden a parfaitement entendu le son de cloche des néoconservateurs qui imprègnent la politique étrangère de son administration, comme la féroce Victoria Nuland. Il n’hésitera pas, en tant que première puissance navale, à engager un face à face pour l’instant conventionnel avec la plus grande puissance terrestre, sur son terrain. Si Biden prend en connaissance de cause ces grands risques dont il n’ignore rien, c’est qu’il a des ambitions qui dépassent le face à face russo-américain. Entre les schémas théoriques et la réalité concrète, entre la doctrine et la vraie guerre, celle qui est en cours, il y a un gouffre. Si Biden a franchi ce gouffre, c’est que autres facteurs sont intervenus dans sa décision de recourir aux armes.
2) Les chemins de la puissance allemande et l’achèvement de Nord Sream 2
Dans la logique de Brzezinski, la domination américaine sur l’Eurasie a pour condition première son emprise sur ses alliés à l’ouest et à l’est du continent, l’Amérique se situant géographiquement à l’extérieur. Or en septembre 2021, une nouvelle attendue avait traumatisé les experts de politique étrangère : le pipeline Nord Stream 2 était achevé et il était en attente de certification par les autorités allemandes. Pendant une décennie les Américains avaient tout essayé pour faire capoter ce projet. Intimidation, procès, pressions diplomatiques maximales, attaque des bateaux usines qui posaient les tuyaux. Il fallut toute l’obstination et l’habileté d’Angela Merkel pour le mener quand même à bon port.
Seymour Hersh raconte comment il allait être accueilli : « L’opposition au Nord Stream 2 s’est enflammée à la veille de l’investiture de Biden en janvier 2021, lorsque les républicains du Sénat, menés par Ted Cruz du Texas, ont soulevé à plusieurs reprises la menace politique du gaz naturel russe bon marché lors de l’audition de confirmation de Blinken comme secrétaire d’État. À ce moment-là, un Sénat unifié avait réussi à faire passer une loi qui, comme Cruz l’a dit à Blinken, “a stoppé [le gazoduc] dans son élan. »
Pourquoi ce pipeline enrageait-il autant le pouvoir américain ? Parce qu’il donnait à l’Allemagne l’opportunité de consolider une relation mutuellement très fructueuse avec la Russie. La puissante économie germanique pouvait ainsi compter sur des sources inépuisables d’énergie à des prix inférieurs au marché. Un cercle vertueux d’activité économique et de productivité était enclenché entre les deux colosses européens, faisant redouter Outre-Atlantique une concurrente coriace sur les marchés mondiaux. Et les velléités d’indépendance d’une Allemagne en pleine ascension envers son traditionnel parrain politique.
Les aspérités de la politique allemande de Washington avaient été clairement exposées par Georges Friedman, un expert en stratégie très proche de la CIA : « l’intérêt primordial des États-Unis pour lequel nous avons fait des guerres pendant des siècles, lors de la première, la deuxième et la guerre froide a été la relation entre l’Allemagne et la Russie, parce qu’unis ils représentent la seule force qui pourrait nous menacer. Et nous devons nous assurer que cela n’arrivera pas. » G. Friedman “… c’est cynique, immoral, mais ça marche“.
L’inquiétude américaine était renforcée par le tour que prenait la relation Allemagne-Chine. Si le modèle allemand trouvait ses ressources primaires en Russie, la dynamique de sa croissance était assurée par la demande chinoise. Là encore un cercle vertueux Allemagne-Chine, mutuellement bénéfique, fonctionnait à plein.
Les États-Unis étaient en train d’assister à un scénario cauchemardesque. L’Allemagne devenait un géant économique qui n’allait pas tarder à taper du poing dans les affaires internationales. Pire encore, par ses liens économiques et technologiques avec la Russie et la Chine, elle favorisait la montée en puissance de deux entités politiquement adverses. Ce n’était pas un rival stratégique de l’Amérique qui étaient en train d’émerger mais trois. La dynamique allemande, par son impact sur la Russie et sur la Chine, accélérait le processus de marginalisation relative de l’Amérique et minorait la force des anciennes relations d’influence qui avaient assis sa domination sur l’Eurasie.
Dans cette nouvelle configuration, il est impossible de programmer l’élimination successive des trois rivaux potentiels car leur dangerosité réside dans les rapports qui les lient entre eux. L’Amérique est face à un système unique, à trois têtes, mais dont l’Allemagne occupe le centre. La doctrine stratégique américaine commandait de disloquer ce système, donc de couper d’une façon ou d’une autre le bras russe et le bras chinois de l’Allemagne. Comment faire autrement pour paralyser le système à trois et, en même temps, contenir préventivement l’ascension de la Russie et de la Chine vers le statut de puissances autonomes, susceptibles de mettre en échec l’imperium américain dans les affaires du monde.
Le programme est copieux. Il faut reconfigurer des liens structurels établis au sein de l’Eurasie, en train de coaguler des savoirs, des ressources et des activités qui marginaliseront à terme l’actuel hégémon. Il n’y a pas d’autre voie aux yeux des néocons au pouvoir pour pérenniser le monde unipolaire hérité du krach soviétique de 1991.
C’est bien ce que dit la doctrine, mais elle ne donne ni calendrier ni mode d’emploi. C’est là que les équipes réunies autour de Joe Biden vont faire preuve de créativité tout en s’appuyant sur de nombreux scénarios et jeux de guerres élaborés par les experts du deep state, pendant le mandat ennuyeux de ce Trump qui ne voulait pas embourber son pays dans de nouveaux conflits.
3) Le choix du moment d’agir
Le choix du moment d’une guerre désirée mêle la détermination des hommes au pouvoir à l’aléa des circonstances.
Au premier rang, la personnalité de Joe Biden puisqu’il exerce le pouvoir et qu’il a autorisé dès son entrée à la Maison Blanche la séquence de décisions planifiées qui placent l’Amérique au centre de la guerre en cours. C’est un homme qui a consacré sa vie à la politique, et s’il est sujet à des pertes d’équilibre et des trous de mémoire, rien n’autorise à sous-estimer son expérience, sa détermination et sa vista. Ni à l’absoudre de son népotisme, de sa fourberie, et de sa vision du monde marquée par la cécité et la violence.
Biden a été le responsable du dossier de l’Ukraine comme vice-président. On ne peut pas lui reprocher de manquer de cohérence dans ses choix En janvier 2017, au moment de quitter sa fonction, il qualifiait déjà la Russie de « principale menace pour “l’ordre libéral international” » avec les mêmes mots qu’aujourd’hui.
Sa connaissance des milieux politiques et économiques ukrainiens (dans lesquels son fils Hunter a été notoirement actif) en fait un expert de ce pays et de ses mœurs. Il était le patron de Victoria Nuland lorsque celle-ci pilotait le coup de Maidan de février 2014 en s’appuyant sur le puissant courant ultranationaliste post-nazi de l’ouest galicien. Il supervisait aussi la politique ukrainienne, lors des offensives de Kiev contre les autonomistes de l’Est, lors de la signature des accords de Minsk et quand il a été décidé de doter l’Ukraine de forces militaires capables de soutenir une guerre.
Dès sa prise de fonctions, il était en mesure de trancher entre les propositions de ses conseillers. Il n’a pas été manipulé par les équipes d’Obama qu’il a reconduites dans les postes officiels des affaires étrangères et du renseignement. Au contraire, il leur a imposé une voie très différente de celle son prédécesseur, celle qu’il avait lui-même tracée comme vice-président. La confirmation de Victoria Nuland (l’épouse de Robert Kagan dans le civil) comme numéro 3 du Département d’État, atteste de cette continuité.
La première urgence de la nouvelle administration est, on l’a vu, le destin du pipeline Nord Stream 2 prêt à l’emploi qui bouleverse tant le Congrès et la Maison Blanche. Dans les mêmes cercles, la seconde source de colère, c’est l’affirmation insolente de la Russie au Moyen-Orient, au point de figurer aussi en tête des questions à régler au cours du mandant qui commence.
En 2007, Vladimir Poutine avait prononcé à Munich devant les chefs d’état occidentaux un discours centré sur le refus du monde unipolaire hérité de la guerre froide, autant dire sur un refus de l’ordre américain. Par la suite, il avait mené une politique indépendante, très contrariante pour Washington en Géorgie en 2008. Enfin, à partir des années 2010, il avait contesté et mis en échec les projets américains dans leur arrière-cour traditionnelle du Moyen-Orient, en Syrie et en Libye. L’insolence russe confinait à l’humiliation avec le processus d’Astana (Kazakhstan) au cours duquel la Russie en compagnie de la Turquie et de l’Iran traitaient du devenir de la Syrie sans accorder aux Occidentaux davantage qu’un strapontin. Bref la Russie se posait comme un joueur coriace sur le théâtre régional.
Brzezinski avait expliqué pourquoi l’Amérique ne pouvait le tolérer un rival, et les néoconservateurs démultipliaient son message, y compris pendant le mandat de Donald Trump, en accusant inlassablement Poutine des pires avanies, par exemple d’une intrusion imaginaire dans l’élection présidentielle de 2016. La Russie contestait la volonté américaine dans son pré-carré. Dans la logique de l’hégémonie cela ne pouvait pas durer.
C’est ainsi que Biden et ses équipes vont élaborer un plan particulièrement audacieux. En une même manœuvre, d’un coup de billard à trois bandes, Biden va tenter de couper à l’Allemagne son bras russe tout en épuisant les forces humaines et matérielles de Moscou, et en même temps, de couper son bras chinois en pourrissant progressivement le climat général des relations de l’Occident avec la Chine. Le risque est immense pour l’avenir de l’Europe mais la partie est jouable car les personnalités transparentes de Scholz et Macron ne feront pas obstacle à l’engagement suicidaire du Vieux Continent dans une guerre qui n’est pas sa guerre.
Jean-Pierre Bensimon
La suite dans la Partie 2…
Source: Dialexis
- Ukraine: une guerre non provoquée, vraiment? (partie 2) - 27 mars 2023
- Ukraine: une guerre non provoquée, vraiment? (partie 1) - 19 mars 2023



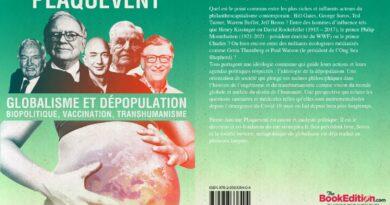




Ping : Essai de rapport de situation sur l'évolution stratégique : la grande stratégie US 2/2 - STRATPOL
Ping : Ukraine: une guerre non provoquée, vraiment? (partie 2) - STRATPOL
Ping : La crise ukrainienne par Jack Matlock - STRATPOL
Pourquoi les allemands se suicident sans résistance ?
Très bonne analyse que je comprends complètement. Le risque venait en effet d’une Allemagne qui tenait sa revanche économique après la perte militaire du 3ème Reich. Car je crois profondément dans l’inconscient collectif des élites Allemandes, l’idéologie de la domination mondiale est toujours bien présente même si elle s’exerce sur un terrain pacifique. Mais avec leur air de ne pas y toucher, je n’ai jamais cru un seul instant à leur sincérité. Il suffit d’observer pour cela de l’attitude Allemande dans ce faux couple Franco-allemand qui n’a jamais cessé d’affaiblir les lignes françaises quelles qu’elles soient. Les exemples ne manquent pas le dernier exemple de l’énergie est une démonstration flagrante, et nos élites préoccupées par leurs nombrils et leurs privilèges n’y ont vu que du feu. Quelque part, la destruction du Nordstream 2 est une chance pour la France si elle réagit vite pour rétablir son industrie nucléaire et son industrie au sens large. Bravo pour cette analyse. Bien à vous.