Première Partie de ce Dossier : le Brésil et sa stratégie de puissance
2. De la Tutelle des Etats-Unis à l’Ambition Internationale
a) Une Alliance Historique
En dépit d’un ‘‘fédéralisme présidentiel’’ très inspiré de celui des Etats-Unis d’Amérique dans la Constitution du Brésil, c’est surtout le Positivisme d’Auguste Comte qui a influencé l’organisation politique du pays, y compris durant les intervalles autoritaires de l’Estado Novo (concept de‘‘Dictature Républicaine’’[footnote title=”41″]A ditadura republicana do Positivismo[/footnote]) ou des régimes militaires (qui reprenaient avant tout à leur comptela notion d’ordre dans la devise du Brésil ‘‘Ordre et Progrès[footnote title=”42″]Influencia do positivismo no Brasil[/footnote]). Le Brésil est (et demeure) également un pays très clairement civiliste[footnote title=”43″]Codigo Civil Brasileiro[/footnote].
Les Etats-Unis n’en furent pourtant pas moins la première nation à officiellement reconnaître son indépendance en 1824, la proclamation de la république en 1889, puis à l’appuyer dans ses premières démarches internationales[footnote title=”44″]Proclamação da República no Brasil[/footnote]. Les Etats-Unis sont toujours le second partenaire commercial et le second investisseur au Brésil[footnote title=”45″]Os Principais Parceiros Comerciais do Brasil[/footnote], et ils constituent par conséquent un partenaire économique, politique et diplomatique incontournable.
Brésiliens et Étatsuniens estiment qu’il existe une vieille alliance tacite et non écrite entre leurs deux pays. De nos jours, la divergence de vue est néanmoins réelle quant à la signification profonde cette alliance. Les Étatsuniens veulent penser que les deux pays respectent assez scrupuleusement leur champs d’influences mutuels : influence globale pour les Etats-Unis, régionale pour le Brésil[footnote title=”46″]BRIGAGAO Clóvis, Brasil: relações internacionais com os Estados Unidos e a América do Sul. Relações Internacionais, Lisboa[/footnote]. Les Brésiliens, en raison d’un ‘‘track-record’’ de vexations et d’un interventionnisme régional récurrent de la part des Etats-Unis, ont pour leur part appris à être méfiants[footnote title=”47″]CHACRA Guga, O Brasil é aliado, amigo, rival ou inimigo dos EUA?, Estadao[/footnote]. Il est vrai qu’à la ‘‘Destinée Manifeste’’ des Etats-Unis[footnote title=”48″]LACOSTE Yves, « Les États-Unis et le reste du monde », Hérodote[/footnote], le Brésil continue d’opposer sa croyance en un exceptionnalisme propre et une vision du monde très autocentrée[footnote title=”49″]THERY Hervé, Le Brésil et le monde, Diploweb[/footnote].
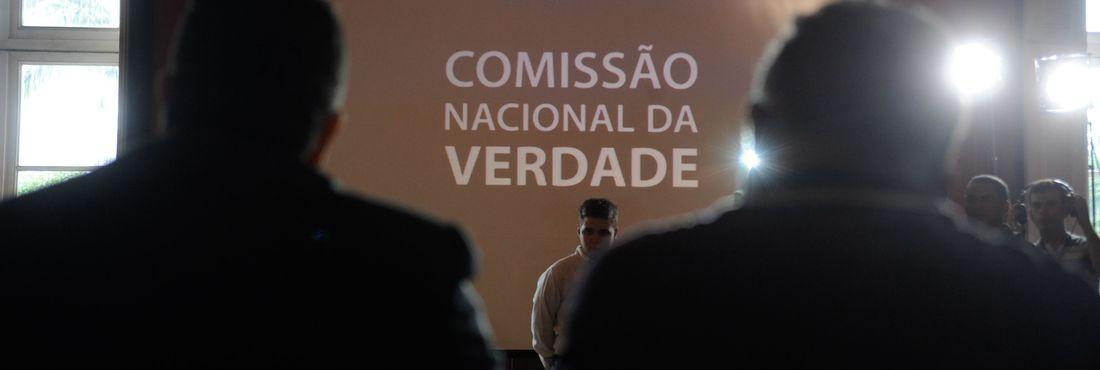
b) Le XXème Siècle et le réalisme brésilien
Après avoir longtemps adopté une position de neutralité stricte, notamment durant la Première Guerre Mondiale (l’Allemagne était alors son premier partenaire commercial, suivi de près par la Grande Bretagne)[footnote title=”50″]Legislação Informatizada – DECRETO Nº 11.037, DE 4 DE AGOSTO DE 1914 – Publicação Original[/footnote], le Brésil fait preuve de beaucoup de pragmatisme vis à vis des EtatsUnis depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ainsi Getulio VARGAS, dirigeant brésilien de l’Estado Novo, dont la doctrine politique aurait logiquement pu l’inciter à se rapprocher des puissances de l’Axe[footnote title=”51″]Estado Novo e Fascismo[/footnote], décide de rejoindre le camp des Alliés (après de nombreuses hésitations) en août 1942. Cette décision, triomphalement accueillie et fortement exploitée par ROOSEVELT, cache pourtant mal les préoccupations de politique régionale et économique que VARGAS avait derrière la tête : s’opposer frontalement à l’influence régionale du voisin et rival Argentin, ainsi que fonder la Companhia Siderurgica Nacional (CSN), champion brésilien de l’acier (aujourd’hui toujours numéro 2 de l’acier et leader mondial des aciers d’emballage[footnote title=”52″]Steel the prize, The Economist[/footnote]), qui allait fournir les Alliés jusqu’à la fin de la guerre. Les États-Unis ne se vantèrent jamais d’avoir fait pencher la balance sur la promesse de ce développement économique essentiel pour le Brésil[footnote title=”53″]Brasil relutou até entrar na Guerra ao lado dos Aliados[/footnote].
La Commission Nationale de la Vérité (‘‘Commissao Nacional da Verdade’’) instituée par la Présidente Dilma ROUSSEF en 2014[footnote title=”54″]site officiel[/footnote] a fini d’établir le rôle déterminant de la CIA et des Etats-Unis tant dans le coup d’état militaire de 1964 (‘‘Opération Brother Sam’’[footnote title=”55″]Brazil marks 40th anniversary of military coup, declassified documents shed light on U.S. role, Audio tape: President Johnson urged taking “every step that we can” to support overthrow of Joao Goulart U.S. Ambassador Requested Pre-positioned Armaments to aid Golpistas; Acknowledged covert operations backing street demonstrations, civic forces and resistance groups[/footnote]) que dans les répressions anti-communistes au Brésil entre 1964 et 1984 (‘‘Opération Condor’’, menée conjointement dans 8 pays sud-américains[footnote title=”56″]As garras do Brasil na Operação Condor, Sul 21[/footnote]). Il est assez remarquable de noter que les militaires brésiliens ne se démarquèrent pourtant pas de leur doctrine de développement national[footnote title=”57″]Evan Ellis, The strategic importance of Brazil, The Global Americans[/footnote] durant cette période, et qu’ils ne furent pas totalement aveuglés par des considérations idéologiques. Sans jamais dissuader l’investissement international, notamment Nord-Américain (directement et via le FMI), ils optèrent cependant durant la période dite du ‘‘miracle économique brésilien’’ pour un protectionnisme strict, qui fut renforcé après le premier choc pétrolier de 1978[footnote title=”58″]Vanini Felipe, A sobrevivência do modelo econômico dos militares, El Pais[/footnote]. Ils choisirent également, comme vu plus haut, de développer des champions nationaux autonomes et nombre d’infrastructures souveraines malgré l’omniprésence de leurs amis nord-américains dans le pays.
On notera avec intérêt que le Brésil n’a en définitive jamais rejoint aucune structure de commandement ou de collaboration formelle avec les Etats-Unis en matière militaire, ni durant la dictature, ni après. Le Ministère de la Défense brésilienne ne fait du reste pas mystère d’avoir toujours formellement refusé (et de refuser encore aujourd’hui) l’extension de l’OTAN à l’Atlantique Sud[footnote title=”59″]Brasil deixa claro: Não queremos a OTAN no Atlântico Sul. A Era Brasil já começou…, Semper Guerra[/footnote].

c) L’émergence du Mercosul et la recherche du statut de Grande Puissance
Les relations diplomatiques privilégiées, le commerce et l’afflux d’investissement entre le Brésil et les Etats-Unis n’ont pas ralenti après la fin de la dictature militaire (1984), et il est même surprenant de voir à quel point des présidents tels que Fernando Henrique CARDOSO, de centre gauche, et surtout Lula DA SILVA, ancien syndicaliste radical, ont pu entretenir des rapports plus que cordiaux avec leurs collègues (même très conservateurs) de Washington (voir l’exemple de Lula et George BUSH Jr[footnote title=”60″]George W. Bush gostava mais de Lula da Silva que de Fernando Henrique Cardoso[/footnote]).
En coulisses, cependant, la naissance du principe du marché commun sud-américain (Mercosul) dès 1984/1985, puis sa formalisation en 1991 et son entrée en vigueur en 1994[footnote title=”61″]Mercosul, Encyclopédie Universalis[/footnote], répondirent aux impératifs de puissance du Brésil, qui fut sa locomotive et souhaitait s’affirmer en tant que véritable patron continental. Le Brésil voyait en effet d’un œil inquiet moins la validation de l’ALENA (marché commun nord américain) en 1993, que les velléités nord-américaines de son extension à un marché américain ‘‘total’’. Cette idée, dans la droite ligne de la Doctrine Monroe, faisait il est vrai son chemin à Washington dans les années 1990[footnote title=”62″]Clinton pour une extension de l’Alena, Libération[/footnote], mais le succès du projet intégrationniste du Mercosul dissuada ses partisans[footnote title=”63″]Etude comparée: Alena et Mercosur[/footnote].
C’est que dans les années 1990, le Brésil commence à affirmer son ambition de grande puissance mondiale, et à intensifier sa présence et son influence auprès de diverses institutions internationales (OMC, FMI, Banque Mondiale, Conseil de Sécurité de l’ONU, participation massive et commandement de la mission en Haïti MINUSTAH de 2004 à 2017[footnote title=”64″]La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) a pris fin, Lignes de Défense[/footnote], etc). Usant d’une diplomatie habile à 180 degrés et de ‘‘soft power’’ pour maximiser leur influence et essayer d’en tirer des bénéfices économiques et politiques rapides, les Brésiliens effectuent depuis le milieu des années 2000 un travail intense de lobbying international afin de notamment changer les règles du Conseil de Sécurité de l’ONU et d’y obtenir un siège permanent[footnote title=”65″]Brasil pode ter assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, acredita Vieira, Senado Noticias[/footnote].
L’analyse des Etats-Unis sur ce dernier point est cependant assez particulière: ils dénigrent très volontiers la démarche du Brésil, dont ils affirment publiquement qu’elle a moins pour objectif d’améliorer l’institution Onusienne que de servir les intérêts partisans et les aspirations de grandeur du pays[footnote title=”66″]La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) a pris fin, Lignes de Défense[/footnote]. Pour les Brésiliens, qui souffrent d’un ‘‘narcissisme à l’envers’’[footnote title=”67″]THERY Hervé, Le Brésil et le monde, Diploweb[/footnote] chronique, il n’en faut guère plus pour exacerber l’idée que l’oppresseur US fait à nouveau preuve d’un paternalisme inacceptable[footnote title=”68″]Los Estados Unidos en la percepción de Brasil, La Honda[/footnote]. La création des premiers sommets à quatre BRIC en 2009[footnote title=”69″]BRICS, Encyclopédie Universalis[/footnote] (BRICS en 2011) fournira dès lors une alternative, certes non institutionnelle, au Brésil dans sa quête de reconnaissance dans un monde qu’il considère désormais multipolaire[footnote title=”70″]BRICS, Investopedia[/footnote]. Le Brésil n’a de surcroît toujours pas renoncé à l’attribution un siège permanent au Conseil de Sécurité[footnote title=”59″]Brasil deixa claro: Não queremos a OTAN no Atlântico Sul. A Era Brasil já começou…, Semper Guerra[/footnote].
 Photo : SIPA USA/SIPA
Photo : SIPA USA/SIPA
d) La dégradation des relations Brésil – Etats-Unis
Les relations entre Brésil et Etats-Unis ne prennent pourtant un tournant particulièrement négatif qu’au début de l’année 2011. En janvier, Wikileaks révèle en effet que les Etats-Unis pèsent de tout leur poids diplomatique, politique et économique pour interdire au Brésil de commencer à produire ses fusées et développer un programme de lancement de satellites sur le site de Alcantara. La version officielle nord-américaine, qui prétend alors publiquement que le transfert de technologie envisagé placerait la Russie plutôt que l’Ukraine en position de partenaire principal du programme spatial brésilien, suscite l’incompréhension de Brasilia[footnote title=”71″]Ucrânia recorreu aos EUA por foguete com o Brasil [/footnote].
Washington redoutait certes qu’un satellite étatsunien ou doté de technologie étatsunienne puisse tomber entre des mains (plus ou moins) russes, mais tout autant la concurrence directe d’un opérateur capable d’aligner des coûts de lancement très compétitifs (environ 30% de moins qu’aux Etats-Unis). L’opinion publique brésilienne retint surtout cet aspect des choses[footnote title=”72″]EUA tentaram impedir programa brasileiro de foguetes, revela WikiLeaks, O Globo[/footnote]. La révélation des moqueries de l’Ambassade des Etats-Unis à Brasilia à propos du ‘‘touriste spatial’’ brésilien Marcos César PONTES (premier brésilien dans l’espace en 2006 et héros national, qui rejoint la Station Spatiale Internationale à bord d’une fusée russe) finit de l’irriter.
Vint ensuite la retentissante affaire SNOWDEN. En juin et juillet 2013, le journaliste Glenn GREENWALD publie une série d’articles relatant les écoutes de la National Security Agency (NSA) dans le monde, dont celles de citoyens et entreprises brésiliens. Le gouvernement émet alors une protestation tiède[footnote title=”73″]Brasil é o país latino-americano mais vigiado pelos Estados Unidos, O Tempo[/footnote]. Le 1er septembre 2013, GREENWALD informe le public brésilien dans le journal ‘‘O Globo’’ que la NSA a mis en place un système ciblé et complexe d’interception des communications de la Présidente ROUSSEFF et de son entourage[footnote title=”74″]Brazil to U.S.: Explain spying, Politico[/footnote]. Dénonçant une ‘‘inacceptable violation de notre souveraineté’’[footnote title=”75″]Brazil Angered Over Report N.S.A. Spied on President, Simon Romero and Randal C. Archibold, The New York Times[/footnote], le Ministre de la Justice CARDOZO et son collègue des Affaires Etrangères convoquent l’Ambassadeur des Etats-Unis Thomas SHANNON à Brasilia. Ils lui annoncent que le Brésil ne se contentera pas d’une simple protestation officiell[footnote title=”76″]Documentos da NSA apontam Dilma Rousseff como alvo de espionagem, Globo[/footnote]. Malgré les excuses téléphoniques du Président OBAMA, Dilma ROUSSEFF annule purement et simplement au mois d’octobre 2013 son voyage officiel à Washington, le premier pour un leader brésilien depuis 1995[footnote title=”77″]Brazil Angered Over Report N.S.A. Spied on President, Simon Romero and Randal C. Archibold, The New York Times[/footnote].
Cette affaire suscitera une réflexion de grande ampleur au Brésil quant à la nécessité d’établir une véritable souveraineté numérique[footnote title=”78″]Voir à ce propos le travail réalisé à l’EGE par Margaux Walck, Julien Lapiz, Quentin Michaud, Sandra Azevedo, Julie Guérin en 2015 (‘‘Souveraineté numérique du Brésil’’)[/footnote], ainsi qu’une implication grandissante des entrepreneurs locaux de l’industrie du high-tech et des pouvoirs publics (convergence notamment avec les standards militaires et recours aux systèmes d’exploitation et logiciels ouverts[footnote title=”31″]Plano de migraçao para software livre no exército Brasileiro, MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO GENERAL GOMES FREIRE DE ANDRADE[/footnote]). En découleront la création du ‘‘Code Civil d’Internet’’ et diverses initiatives destinées à protéger les données privées et à garantir la neutralité d’internet. Les brésiliens affirment aussi dès lors leur volonté de s’affranchir de la tutelle de l’infrastructure des câbles sous-marins étatsuniens. Les résultats dans ce domaine demeurent limités, mais les ambitions spatiales du Brésil sont incontestablement liées à cette idée[footnote title=”79″]Para que serve o Programa Espacial Brasileiro?[/footnote].
L’affaire SNOWDEN aura de surcroît des répercussions sur la scène internationale. Madame ROUSSEFF prononce en septembre 2014 un discours très offensif à l’encontre des pratiques de la NSA lors de l’Assemblée Générale de l’ONU. Le journaliste GREENWALD qualifiera cette intervention de ‘‘plus courageuse que celle de tous les Chefs d’Etats et Gouvernements européens confondus’’[footnote title=”80″]Greenwald: “O Brasil ousou mais do que a Europa”[/footnote]. En 2014, le Brésil ne se prive pas d’émettre de grandes réserves à la formation d’une coalition menée par les Etats-Unis pour combattre l’Etat Islamique en Irak et au Levant, et garde un silence remarqué au Conseil de Sécurité suite aux évènements en Crimée[footnote title=”81″]Andres Oppenheimer: Brazil makes it hard to back key U.N. reforms, Miami Herald[/footnote].
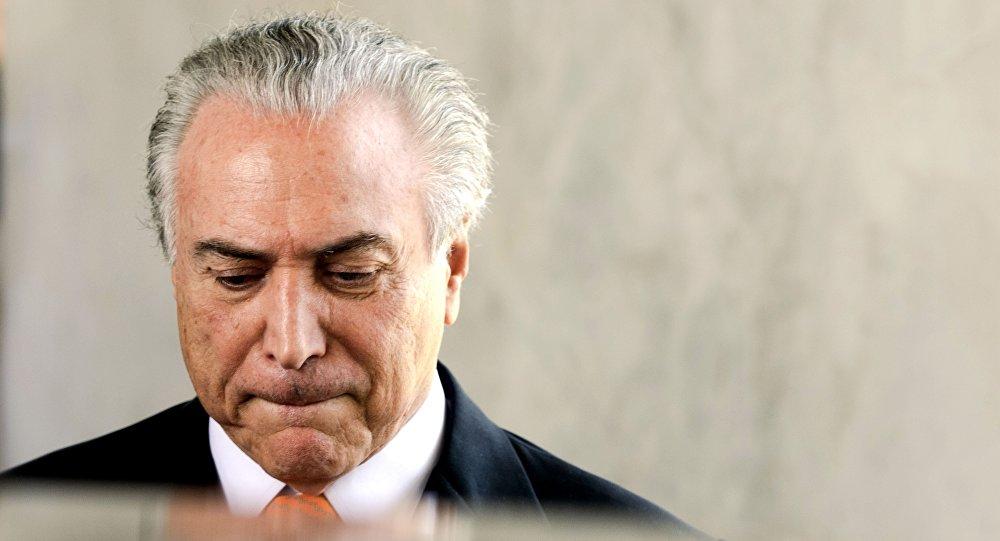
Photo : Marcelo Camargo/FotosPúblicas
e) Le présent : retour spectaculaire de l’influence des Etats-Unis
Il serait simpliste et réducteur de penser que les relations entre le Brésil et les Etats-Unis, notamment dans la sphère militaire et militaro-industrielle, aient souffert autant que les effets de manche de Madame ROUSSEFF à l’ONU pourraient le laisser penser. Le retour sur l’avant de la scène (même rendu difficile par leurs récurrentes affaires de soupçons de corruption[footnote title=”2″]Ibope Divulga pesquisa sobre popularide de Michel Temer, Globo.com[/footnote]) de l’ex Vice-Président Michel TEMER et de ses proches au parlement de Brasilia, a ainsi rouvert la porte aux Etats-Unis sur un certain nombre de dossiers très révélateurs[footnote title=”82″]Temer recebe bem proposta da Boeing, Defesanet[/footnote].
Le Président TEMER, vieux briscard de la politique brésilienne, aurait selon Wikileaks joué le rôle d’informateur des services de renseignement de l’Ambassade US à Brasilia depuis denombreuses années (au moins depuis 2006)[footnote title=”83″]Wikileaks diz que Michel Temer atuou como informante dos EUA[/footnote]. On s’étonnera dès lors peu de sa rencontreinformelle avec le Président TRUMP en marge du sommet du G20 en Allemagne (juillet 2017), puis de son invitation à dîner à Washington de septembre 2017. Ce dîner, durant lequel Monsieur TEMER devait officiellement aborder le sujet de désaccords commerciaux[footnote title=”84″]Disputas comerciais devem tornar indigesto jantar de Temer e Trump[/footnote], eut une conséquence pour le moins étonnantes : une salve assez frénétique de projets de lois propices aux Etats-Unis et à leurs entreprises.
Profitant d’un Sénat pratiquement vide un soir de débats à rallonge[footnote title=”85″]SOBERANIA DO BRASIL. REQUIÃO DENUNCIA ENCOMENDA PARA DAR ESPAÇO AÉREO E EMBRAER AOS EUA. O QUE FALTA ENTREGAR?[/footnote], les alliés du Président font discrètement passer en novembre 2017 un projet de loi anodin qui contient une disposition ouvrant l’espace aérien brésilien à des entreprises privées étrangères[footnote title=”86″]Disputas comerciais devem tornar indigesto jantar de Temer e Trump[/footnote]. En mars 2018, le gouvernement fait adopter par ce même Sénat, malgré les vives protestations de quelques membres de l’opposition de droite et de gauche, un second projet de loi sanctionnant un accord international d’une durée de 20 ans entre le Brésil et les Etats-Unis : l’Accord sur les Cieux Ouverts (‘‘Acordo de Ceus Abertos’’)[footnote title=”87″]Senado aprova acordo de ‘céus abertos’ entre Brasil e Estados Unidos[/footnote].
Cet accord prévoit, par extension explicite de la loi de novembre 2017, qu’il existera désormais une libre-concurrence avec une interférence minimale des pouvoirs publics dans le transport aérien entre les deux pays. Il dispose encore d’un élargissement sans précédent de la ‘‘coopération scientifique et technologique spatiale’’, lequel permettra aux agences et entreprises étatsuniennes de s’implanter sur et autour du site de lancement brésilien d’Alcantara, ou encore à la société US Viasat de devenir fournisseur du Système Géostationnaire de Défense et Communications Stratégique (SGDC) brésilien[footnote title=”88″]Senado aprova acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso pacífico do espaço, EBC[/footnote]. Pour mémoire, le Président Fernando Henrique CARDOSO avait établi le principe de l’interdiction totale du recours à du personnel non-brésilien sur ou autour des sites spatiaux dans les années 1990[footnote title=”89″]Temer entrega as chaves de Alcântara aos Estados Unidos, Viomundo[/footnote]… D’autres projets à des stades plus ou moins avancés incluent la privatisation partielle ou totale de secteurs considérés stratégiques, tels les que les concessions de recherche pétrolière sur lelittoral (zone ‘‘Amazonia Azul’’) ou la privatisation de la compagnie nationale de Pétrole (PETROBRAS)[footnote title=”90″]Temer está avaliando proposta de parceria entre Boeing e Embraer, Exame[/footnote].
Feignant le courroux, Michel TEMER annonce fin février 2018 qu’il s’oppose à la ‘‘vente pure et simple à 80 ou 90%’’ à l’étatsunien Boeing des activités civiles de l’avionneur Embraer, leader mondial des jets régionaux et chef de file du complexe militaro-industriel brésilien. Boeing déclare pour sa part vouloir simplement réagir à l’alliance commerciale entre Bombardier et Airbus sur les avions moyen-courrier, conclue en octobre 2017[footnote title=”91″]Coup de tonnerre, Airbus s’allie à Bombardier face à Boeing, La Tribune[/footnote], et se dit ouvert à toutes les options.
La firme étatsunienne ‘‘comprend la préoccupation des autorités brésiliennes’’, et prétend finalement accepter l’idée d’un ‘‘partenariat’’ plutôt que celle d’un achat stricto sensu. La logique commerciale ‘‘gagnant-gagnant’’ profiterait selon elle largement aux deux pays. TEMER annonce donc avec satisfaction que la part de Boeing dans le nouveau consortium ne ‘‘dépassera pas 51%’’, et que les brésiliens conserveront des ‘‘golden shares’’ dotées d’un droit de véto sur les décisions stratégiques[footnote title=”92″]Boeing seeks to salve Brazil concerns over Embraer approach, Reuters[/footnote].
Apparemment inquiets, les suédois de SAAB, qui ont conclu un important accord avec la branche militaire d’Embraer en mai 2017 (fourniture d’une centaine de jets ‘‘Gripen’’ avec d’importants transferts de technologie vers le Brésil[footnote title=”93″]Brasil surpreende Suécia com contraoferta à Saab sobre venda de aeronaves, Sputnik[/footnote]), sont rassurés par le Ministre de la Défense Raul JUNGMANN: Embraer ne passera pas ‘‘sous contrôle’’ de Boeing, et ses activités de défense ne seront pas concernées par le possible accord[footnote title=”94″]Jungmann diz a Saab que venda da Embraer não está em negociação, diz Defesa, Reuters[/footnote].
Dès décembre 2017, pourtant, les spécialistes nord-américains de l’industrie de défense[footnote title=”95″]Here’s how a Boeing takeover of Embraer could play out, DefenseNews[/footnote] annonçaient sans détours que les visées de Boeing à travers Embraer étaient selon eux totalement liées à des débouchés militaires au Brésil et dans la région. Ils remarquaient également les rapprochements technologiques et commerciaux entre SAAB et la firme nord-américaine sur de nouvelles classes d’avions de combat et d’entraînement, notant au passage que Boeing avait fait preuve d’un inhabituel manque de combativité pour placer ses F18 ‘‘Super Hornet’’ lors de l’appel d’offre remporté par les suédois.
 Photo : Dado Galdieri / The New York Times
Photo : Dado Galdieri / The New York Times
f) L’entrisme des Chinois
Bien que ces chiffres ne soient pour l’heure pas confirmés, la Chine serait devenue le premier investisseur étranger au Brésil en 2017[footnote title=”96″]China becomes Brazil’s biggest investor so far in 2017, Chia Daily[/footnote]. Près de 235 projets d’investissement direct seraient en cours, dont 87 projets fermes représentant un total de 46,8 milliards de dollars dans les secteurs de l’énergie, pétrole et gaz, industries lourdes, agriculture, agroalimentaire. Nombre de ces projets d’investissement prennent la forme de fusions-acquisitions entre des entreprises brésiliennes et des compagnies chinoises de toutes typologies (entreprises publiques, mixtes, privées, et même individus très fortunés)[footnote title=”97″]China announces 235 investment projects in Brazil between 2003 and 2017, Macahub[/footnote].
L’intérêt de la Chine pour le Brésil est relativement récent, puisqu’avant 2004, il n’existait de liens commerciaux qu’assez lâches entre les deux pays[footnote title=”98″]Girardi Mendonça, Fabianna Kenia Silva, EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO BILATERAL ENTRE BRASIL E CHINA: ANÁLISE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS[/footnote]. On peut affirmer que les choses ont bien changé, puisque les chinois sont devenus les premiers partenaires commerciaux du Brésil, devançant très nettement les Etats-Unis[footnote title=”45″]Os Principais Parceiros Comerciais do Brasil[/footnote].
Plus étonnants et moins connus sont les liens croissants qui existent en matière militaire et spatiale entre les deux pays. Il est vrai, et la Chine le sait bien, que l’armée brésilienne est plus grande et plus riche que toutes les autres armées continentales confondues. Consciente de la décision du Ministère de la Défense brésilien en 2012 de limiter sa dépendance vis à vis des fournisseurs étrangers[footnote title=”99″]Brazil’s Defense Industry – Market Report 2012-2017, Defense Update[/footnote], elle n’a guère poussé à la vente d’armes au Brésil. Les Chinois ont même su ne pas frontalement s’opposer à l’industrie de la défense brésilienne sur des appels d’offre régionaux jugés peu stratégiques[footnote title=”100″]Evan Ellis, The strategic importance of Brazil, Global Americans[/footnote].
En réalité, ils se sont surtout positionnés avec le Brésil sur la fourniture de technologies ou de savoir-faire très spécifiques, dont ils savaient qu’elles leur attireraient les faveurs du commandement militaire :
- Discussions avancées avec la China Shipbuilding Industry Corporation concernant la fourniture de frégates à même de policer la zone ‘‘Amazonia Azul’’[footnote title=”101″]Site officiel de China Shipbuilding Industry[/footnote] ;
- Transferts de technologie dans la mise en place d’un système intégré de contrôle des frontières maritimes (Système SisGAAz)[footnote title=”102″]Exclusivo SisGAAz – 3 Main Contractors Apresentam-se, DefenseaNet[/footnote] ;
- Fourniture d’un navire de recherche antarctique[footnote title=”100″]Evan Ellis, The strategic importance of Brazil, Global Americans[/footnote] ;
- Programme sans précédent de formation des officiers de marine à l’Université de Nanjing[footnote title=”100″]Evan Ellis, The strategic importance of Brazil, Global Americans[/footnote] ;
- Co-développement de quatre satellites[footnote title=”103″]Evan Ellis, “China’s Activities in the Americas”[/footnote].
A l’inverse des étatsuniens souvent jugés autocentrés, les militaires Chinois ont su tisser des liens personnels très forts avec leurs collègues brésiliens en :
- Participant régulièrement au très célèbre cours de survie dans la Jungle Amazonienne près de Manaus[footnote title=”104″]Militares chineses fazem treinamento na selva com Exército Brasileiro, Defensa & Seguranca[/footnote]. Ils ont annoncé vouloir s’appuyer sur l’expertise brésilienne pour ouvrir leur propre école en Chine du Sud[footnote title=”105″]Militares chineses pedem ajuda ao Brasil com treinamento na selva, Sputnik[/footnote] ;
- Envoyant des troupes pour participer à la force de la MINUSTAH en Haïti[footnote title=”106″]Statement by Ambassador WU Haitao at the Security Council Debate on Haiti[/footnote], opération qui vient de s’achever, et dont on se souvient qu’elle était sous commandement brésilien.
Les officiers supérieurs et chargés d’affaire chinois au Brésil parlent couramment portugais, un effort que nombre de militaires et entrepreneurs brésiliens apprécient[footnote title=”100″]Evan Ellis, The strategic importance of Brazil, Global Americans[/footnote]. Dans de récents discours face au grand patronat brésilien, le représentant de l’Ambassade de Chine Song Yan, n’hésitait en outre pas à les inciter à se jeter à l’assaut du colossal marché asiatique[footnote title=”107″]Diplomata chinês instiga empresários brasileiros a conquistar a Ásia, UOL[/footnote].
Inutile de dire que cet appel d’air, venant d’un pays qui n’est pas considéré comme un rival régional[footnote title=”108″]Anna Ruth Dantas, Brasil nao tem inimigo no mundo[/footnote], n’est pas passé inaperçu.
- Révélations et soupçons de corruption de Nicolas Sarkozy au Brésil - 19 mars 2019
- Russie en Amérique Latine : pièges et opportunités - 29 janvier 2019
- [DISSENSION] : Brésil de Bolsonaro : pour une grille de lecture « vue de droite » - 16 janvier 2019







